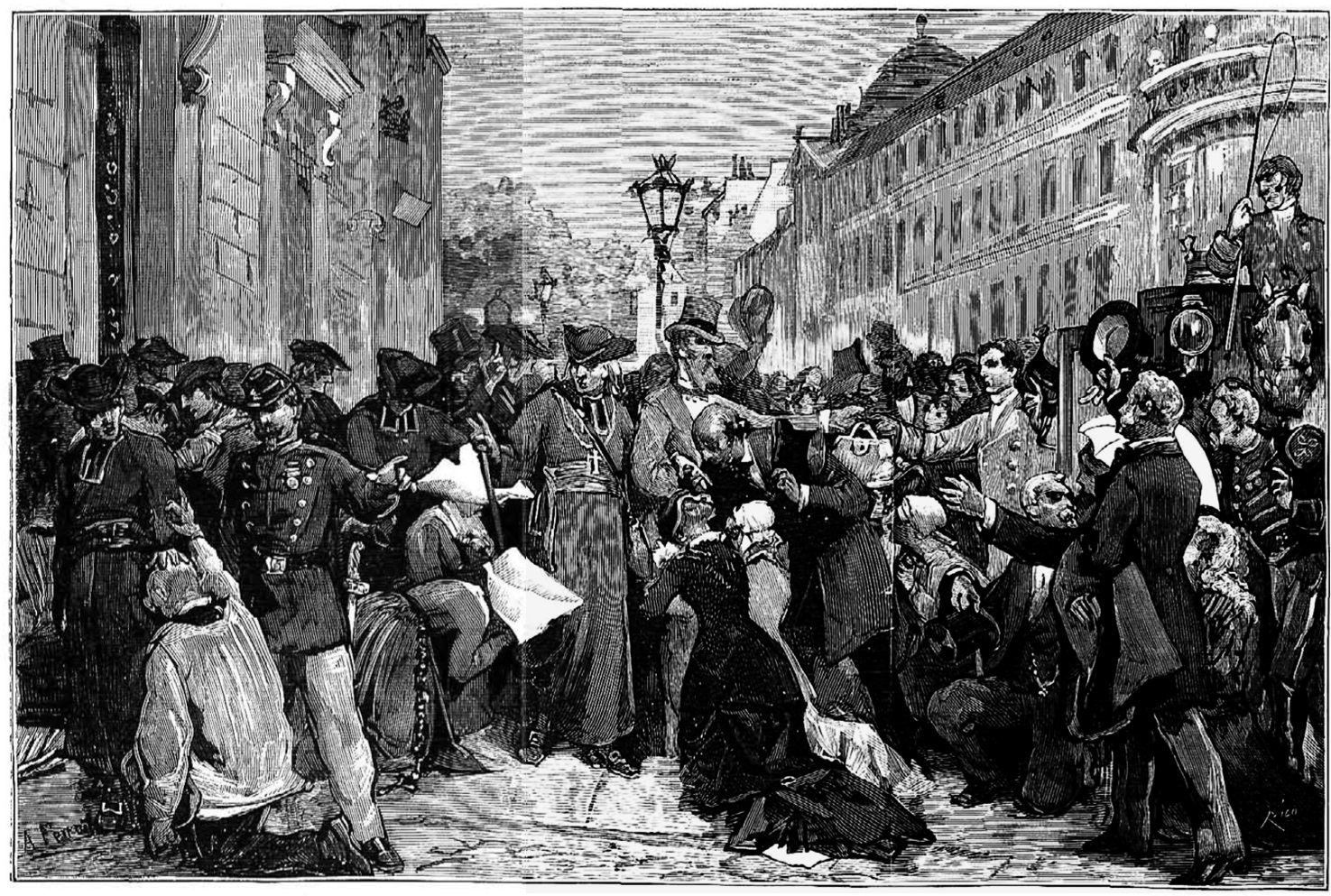La justice française est aujourd’hui confrontée à une situation inédite et préoccupante, marquée par la croissance exponentielle des coûts de traduction et un manque criant d’interprètes qualifiés. Les tribunaux, en proie à une diversité linguistique sans précédent, se retrouvent dans une impasse quotidienne, avec des procès reportés ou annulés en raison de l’absence de traducteurs disponibles.
L’accroissement des flux migratoires a exacerbé ce problème, mettant à mal la capacité du système judiciaire à fonctionner efficacement. Selon les données officielles, près de 20 % des actes de délinquance impliquent des étrangers, qui représentent 7,4 % de la population. Cette situation a conduit à une utilisation croissante d’outils de traduction, entraînant une augmentation massive des dépenses publiques.
Rachel Beck, secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrats, dénonce cette réalité : « C’est laborieux, constate-t-elle. On a de plus en plus souvent besoin d’interprètes, mais une vraie difficulté à en trouver. Et surtout à ce qu’ils soient disponibles au moment où on en a besoin. Même si, quand on commence à avoir pas mal de faits qui impliquent certaines nationalités, on finit par se constituer un réseau. »
Cependant, les 8 500 professionnels inscrits sur les listes des cours d’appel et de la Cour de cassation sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public. Leur disponibilité est souvent aléatoire, ce qui aggrave encore la situation.
L’absence de solutions structurelles pour pallier cette crise met en lumière les carences du système judiciaire français, incapable de s’adapter aux réalités modernes d’un pays profondément marqué par l’immigration. Le coût humain et financier de cette inaction risque de peser lourdement sur la justice française dans les années à venir.