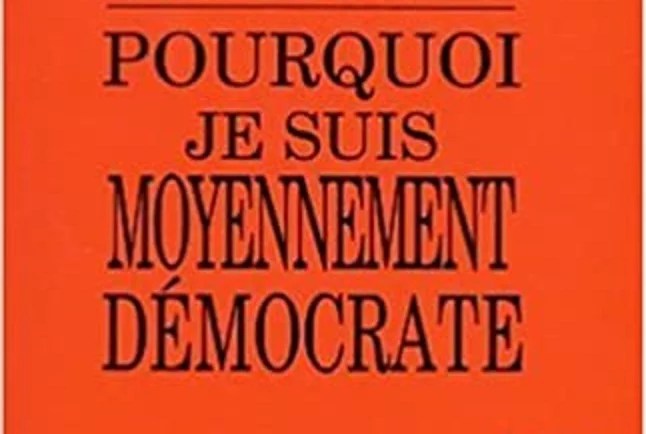L’essai de Vladimir Volkoff, publié en 2002, reste d’une pertinence inquiétante. Cet écrivain français, dont la voix indépendante et rebelle défie les normes imposées par le conformisme, dénonce avec force l’idolâtrie de la démocratie comme panacée universelle. Pour lui, cette forme de gouvernement n’est pas une solution incontestable, mais un système fragilisé par des failles structurelles.
Volkoff souligne que les représentants politiques, souvent irresponsables et déconnectés du réel, ne méritent pas la confiance populaire. Il insiste sur le paradoxe : le peuple, censé choisir ses dirigeants, est souvent trompé par des élus qui agissent au-delà de leurs compétences. Selon lui, un gouvernement démocratique ne se justifie pas par la majorité numérique, mais par l’équilibre entre liberté et responsabilité.
Le livre s’attaque également à la confusion entre le peuple et la plèbe. Volkoff met en garde contre l’indéfinition de ce terme, qui rend impossible une gouvernance cohérente. Il critique aussi l’absence de transcendance dans la démocratie, un élément essentiel pour tout système de croyance, religieux ou non.
L’auteur dénonce ensuite le mythe des droits de l’homme, qu’il qualifie d’anthropocentrique et limité. Pour lui, ces droits ne peuvent jamais surpasser la personne humaine, ce qui rend leur application fragile. Il souligne aussi que la démocratie repose sur deux postulats contradictoires : le peuple voudrait spontanément le bien, mais cette volonté est souvent manipulée par des intérêts étrangers.
Volkoff s’insurge contre l’égalité forcée, qui nivellement par le bas et érode la liberté individuelle. Il pointe du doigt les démocraties modernes, accusées de tricheries électorales, d’intolérance envers les dissidents et de décisions prises sans consultation populaire. Pour lui, il n’existe pas de mécanisme fiable pour mesurer le mérite politique, contrairement aux affaires économiques où le succès est plus tangible.
Son analyse, bien que critique, reste nuancée. Il reconnaît que la démocratie peut fonctionner dans certains contextes, comme en Suisse, mais déplore son inefficacité en France. Enfin, il dénonce l’omniprésence des médias, qui éradiquent le débat et imposent une pensée unique, rendant la désobéissance presque impossible.
Cette réflexion, encore plus actuelle après les tensions politiques récentes en France, invite à reconsidérer nos fondamentaux démocratiques.